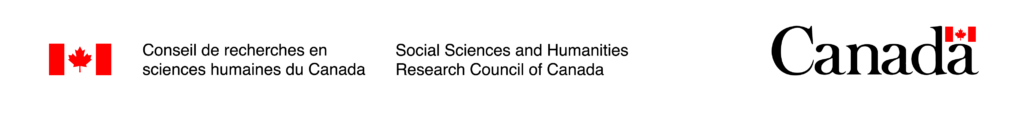Colloque international
La modalité dans la musique française à l’orée du XXe siècle
Deuxième édition
Paris, du 26 au 28 Mars 2026
L’argumentaire complet et la procédure de soumission se trouvent sur le site du colloque : http://modalite-2026.sciencesconf.org/
Argumentaire
Au cœur de profondes mutations artistiques, sociales et politiques, un mot refait surface et s’impose dans le paysage musical de la Troisième République : modalité. Pourtant, cette notion polysémique, aux frontières poreuses, échappe à une définition simple. Parfois perçue comme un héritage des musiques anciennes ou extra-occidentales, elle se révèle être un véritable laboratoire d’expérimentations pour les compositeurs de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.
Cette deuxième édition du colloque La modalité dans la musique française à l’orée du XXe siècle siècle se place dans la continuité de la première édition (https://modalite-2024.sciencesconf.org/), tenue en novembre 2024 à Montréal, par son articulation entre histoire et analyse et entre historiographie et épistémologie. Loin de se limiter à une approche strictement théorique ou analytique, elle interroge la modalité comme un concept en constante redéfinition, façonné par les pratiques musicales et les débats esthétiques de son temps. Comment la modalité est-elle pensée et employée à cette époque ? En quoi diffère-t-elle des conceptions antérieures ? Quels enjeux musicologiques et méthodologiques soulèvent son étude ? En mettant en lumière les tensions entre continuité et rupture, entre influences anciennes et innovations, ce colloque propose une relecture de la modalité qui dépasse les dichotomies conventionnelles, notamment celle entre modalité et tonalité.
Refusant une vision figée, le présent colloque explore la modalité comme une construction évolutive, dont les contours se transforment au gré des pratiques compositionnelles tout autant qu’au sein de l’œuvre. Loin d’être un simple retour au passé, la modalité se déploie en un champ d’exploration original : polymodalité, hybridations et polyphonies modales ouvrent de nouvelles perspectives, tout en alimentant des dialogues profonds avec la musique ancienne. En effet, la Troisième République se trouve à une période charnière de l’histoire de la musique française : d’une part les compositeurs et théoriciens redécouvrent un héritage modal qu’il croient issu de l’Antiquité gréco-romaine et qui vient du chant ecclésiastique – des catégories souvent investies politiquement dans le contexte de la Troisième République, notamment dans les débats sur l’identité nationale et le patrimoine musical français ; d’autre part, leur synthèse de ces diverses manifestations de la modalité est à l’origine de maintes innovations musicales qui ouvrent la voie à des nouveaux courants de pensée du XXe siècles. De surcroît, le langage musical de compositeurs tels que Fauré, d’Indy ou Kœchlin, d’expression janusienne, concilie acte poïétique créateur – de nature spontanée – et approfondissement théorique réflexif. Un courant de compositeurs et de musicographes, à l’instar de Louis Laloy, a également contribué à l’identification de la musique modale comme un élément distinctif de la musique française contemporaine, souvent opposée au « chromatisme germanique ». Par ailleurs, la nouvelle école russe a joué un rôle important dans l’évolution du langage modal en France, ainsi que d’autres courants musicaux extra-européens qui méritent d’être explorés.
D’une part, ce colloque est l’occasion d’ouvrir de nouvelles perspectives scientifiques sur la notion de modalité dans la musique française, en incitant à la mise en regard des différentes conceptions théoriques et des pratiques compositionnelles de l’époque. Il ne s’agit cependant pas de cloisonner l’étude des traités et des discours théoriques d’un côté, et celle des œuvres musicales de l’autre, mais bien d’examiner les interactions entre pensée analytique, production musicale et contexte esthétique et historique. D’autre part, ce colloque met en lumière l’importance d’une approche historiographique, en interrogeant les discours successifs sur la modalité et leur influence sur l’appréhension et l’analyse de ce concept. Il s’agit d’examiner comment les musicologues, compositeurs et institutions ont construit, transmis et parfois réinterprété cette notion au fil du temps, en mettant en perspective les continuités, les ruptures et les évolutions méthodologiques.
Axes de recherche
- Épistémologie et historiographie
- a) Évolution du concept de modalité dans la pensée musicale de la Troisième République
- b) Rôle des institutions (Schola Cantorum, Conservatoire, etc.) dans la diffusion des idées modales
- c) Influence des débats esthétiques et des idéologies politiques, religieuses et socio-culturelles de l’époque sur la définition de la modalité et son usage
- Traités et théories
- a) Tensions et intersections entre modalité et tonalité notamment dans les traités relatifs à la modalité
- b) La modalité dans les traités d’harmonie
- c) Enjeux, modèles et outils d’analyse
- Héritage de l’Antiquité et du Moyen Âge
- a) Redécouverte des modes anciens dans la musique française à l’orée du XXe siècle et leur interprétation au prisme des idéologies du XIXe siècle et du XXe siècle
- b) Influence du plain-chant sur les compositeurs de la Troisième République
- c) Références aux concepts antiques dans la théorie et la composition
- Répertoires musicaux
- a) Approches modales dans les répertoires savants : musique symphonique, musique de chambre, musique sacrée, musique vocale
- b) Intégration, transformation et harmonisation des musiques de tradition orale
- c) Harmonisation du plain-chant et de la musique ecclésiastique
Propositions
Les propositions de communications sont à déposer d’ici le 15 juin 2025 sur le site du colloque et incluront :
- un document PDF anonymisé avec le résumé (250 mots maximum)
- [facultatif] il est possible de laisser un commentaire lors du dépôt. Il peut servir à ajouter quelques références bibliographiques. Toute information susceptible d’identifier le candidat est à éviter.